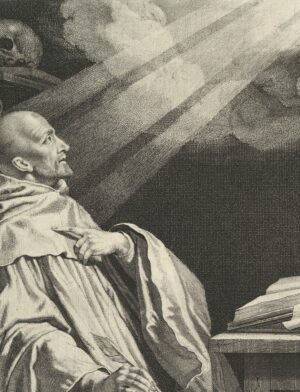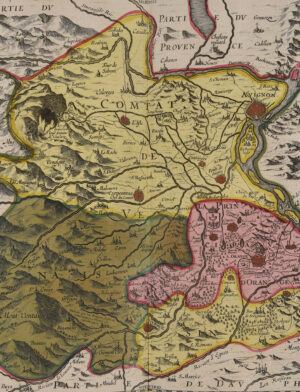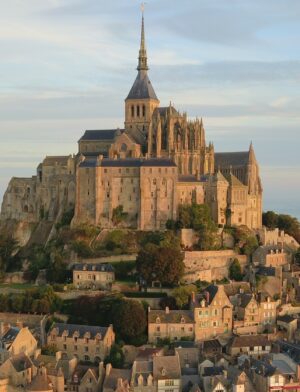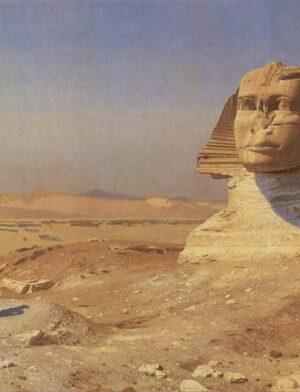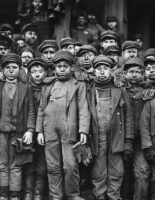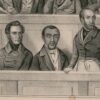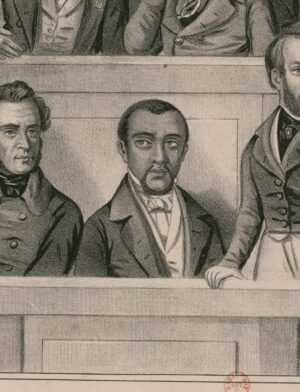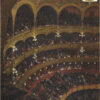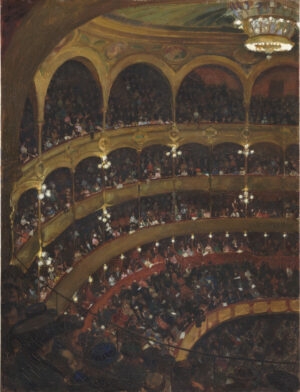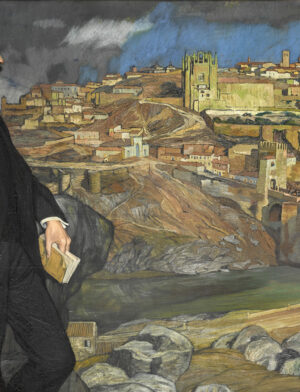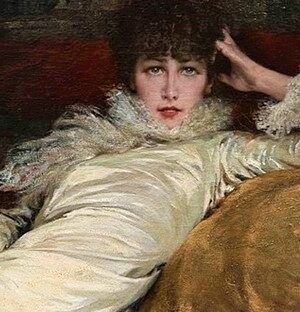AU FIL DE L’HISTOIRE
LA MÉMOIRE
EN QUESTIONS

La mémoire peut souder une nation, mais elle est aussi souvent conflictuelle. France Mémoire se propose d’en interroger les enjeux. Dans une série d’émissions de radio sur Canal Académies, France Mémoire donne la parole à des spécialistes des questions mémorielles et des rapports entre histoire et mémoire.
France Mémoire est le service créé par l’Institut de France en remplacement de l’ancienne délégation aux Commémorations nationales. Il est indépendant du gouvernement.
France Mémoire a pour mission, au niveau national, de nourrir la mémoire en diffusant largement des connaissances historiques et en organisant des commémorations.
Chaque année, France Mémoire établit un calendrier d’anniversaires (cinquantenaires, centenaires et leurs multiples). Pour chaque date, un dossier inédit est mis en ligne sur ce site.